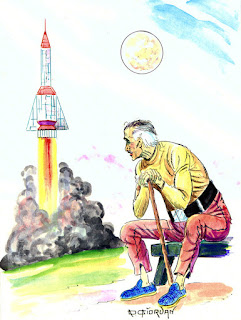Iain
Banks - Un chant de pierre - l’œil d’or
Venant en post-scriptum
de mes lectures 2016 Un chant de pierre de Iain Banks appartient à cette
catégorie de roman hors genre où l’auteur du cycle de la Culture se livrait à
des expérimentations littéraires à l’image de Efroyabl ange1.
S’il se révèle plus
abordable que celui-ci, notamment dans ses inventions langagières, Un chant
de pierre met la barre stylistique à un haut niveau. Ce récit de guerre
qualifié opportunément de conte cruel, raconte la déchéance et la fin tragique
d’un couple d’aristocrates. Alors qu’ils suivent une colonne de réfugiés fuyant
la zone des conflits dans une contrée et à une époque inconnues, une
soldatesque réquisitionne leur chariot, et les oblige à faire demi-tour vers le
château familial qu’ils s’étaient pourtant résolus à abandonner. La bande armée
toute heureuse d’y trouver gîte et couvert s’y livre progressivement à des
exactions.
Manoirs et châteaux sont
le refuge littéraire des crimes et des fantasmes. L‘ouvrage de Iain Banks n’ y
fait pas exception et referme son propos sur une narration conduite par le châtelain.
Evénements tragiques, réminiscences, souvenirs se déploient dans un même champ
contemplatif, une même intériorité. L’écriture est comme détachée. Il y a bien
quelques scènes d’actions mais comme voilées par cette sorte d’anesthésie de la
conscience, qui dit t’on frappe les témoins de scènes de guerre. Un autre
personnage en contrepoint du narrateur tire profit de ce huis clos Le chef de
la bande, une femme, prend plaisir à s’intercaler au milieu du couple et y
impose un jeu de séduction et d’humiliation.
De fait un chant de
pierre n’est pas un roman de l’attente comme Le rivage des Syrtes ou
Le désert des tartares, suggérés par l’éditeur, dans le quatrième de
couverture mais plutôt le lieu des supplices. On y respire l’odeur des fougères
et des forêts, le sang se mêle à la glaise et au limon. Aurore écarlate, séquences
de cruautés semblent participer d’un même ordre cosmique.
Le projet initial de Iain
Banks consistait dit t’on à élaborer un poème narratif. On le croira bien
volontiers à la lecture de ces lignes ; « La voilà la demeure
battante, entreprise close, recroquevillée sur un vide intime et bien gardé
[…] » qui renvoient à un texte d’Yves Bonnefoy (1) :
« Je nommerai
désert ce château que tu fus,
Nuit cette voix,
absence ton visage,
Et quand tu tomberas
dans la terre stérile
Je nommerai néant
l'éclair qui t'a porté.
Mourir est un pays que
tu aimais. Je viens
Mais éternellement par
tes sombres chemins.
Je détruis ton désir,
ta forme, ta mémoire,
Je suis ton ennemi qui
n'aura de pitié.
Je te nommerai guerre
et je prendrai
Sur toi les libertés
de la guerre et j'aurai
Dans mes mains ton
visage obscur et traversé,
Dans mon coeur ce pays
qu'illumine l'orage »
L’ouvrage serti de onze
gravures, mérite une place de choix dans toute bibliothèque qui se respecte.
(1) Du mouvement et de l'immobilité de Douve